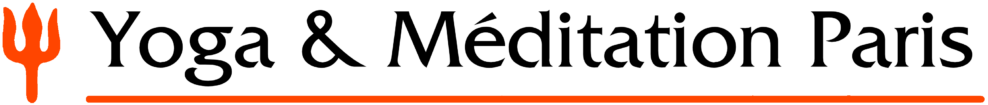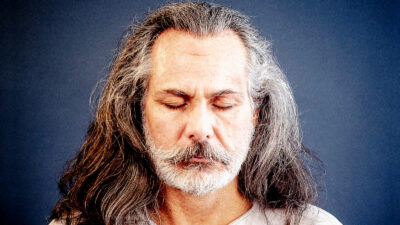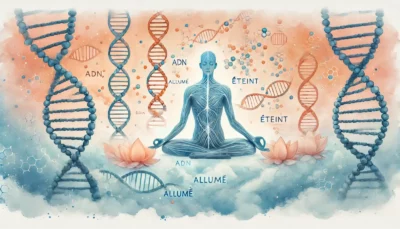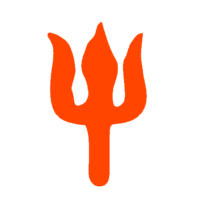Ce qui se passe dans le corps quand on retient le souffle

Retenir son souffle est bien plus qu’un acte de volonté. Dans les pratiques yogiques comme le pranayama, cette rétention consciente ouvre une porte vers une tranquillité profonde. Pratiquée avec intention, elle déclenche une cascade de réactions puissantes dans le corps et le cerveau. Plongez avec nous dans cette chronologie précise pour comprendre pourquoi cette pratique est si précieuse pour votre bien-être.
Chronologie : comment le corps réagit à la rétention du souffle (kumbhaka)
Les pratiquants de yoga retiennent leur souffle de manière calme et consciente, généralement assis en posture de méditation. L’état intérieur est déjà paisible. Voici ce qui se passe minute par minute.
Les 15 premières secondes
Tout commence dans la tranquillité. Le souffle vient d’etre suspendu, mais l’apaisement commence déjà — sans effort, sans tension.
- Les niveaux d’oxygène (O₂) et de dioxyde de carbone (CO₂) restent globalement stables.
- Sensation calme et détendue, même pour les débutants.
Après 30 secondes
Peu à peu, sous la surface du calme, les premiers ajustements physiologiques commencent à se faire sentir.
- L’oxygène reste stable mais le CO₂ commence à s’accumuler lentement.
- Le pH sanguin baisse légèrement. Le cerveau reçoit les premiers signaux pour respirer.
- C’est la montée du CO₂, et non le manque d’oxygène, qui crée l’envie de respirer.
- Les débutants commencent à ressentir de l’inconfort.
- Les pratiquants expérimentés approfondissent leur détente.
- Le rythme cardiaque commence à baisser.
Entre 1 et 2 minutes
C’est ici que la rétention devient un vrai test de présence. Pour le corps non préparé, le confort s’estompe ; pour le yogi, le calme s’intensifie.
- Pour les non-entraînés, atteindre une minute est difficile. L’inconfort déclenche des pensées stressantes qui augmentent la consommation d’oxygène.
- Pour les yogis expérimentés, le calme s’approfondit encore.
- L’activité parasympathique augmente.
- Le CO₂ continue de s’élever, mais les niveaux d’oxygène restent sûrs.
Entre 2 et 3 minutes
Le corps entre dans un mode de préservation. Il ne cherche plus à fonctionner normalement : il cherche à durer. Maintenant les débutants et même les intermédiaires ont déjà arrêté.
- Le niveau d’oxygène commence à baisser de manière plus significative.
- Chez les personnes entraînées, les niveaux restent encore dans une zone de sécurité.
- Le réflexe d’immersion des mammifères s’active (Panneton, 2013) :
–Bradycardie : ralentissement du cœur
–Vasoconstriction périphérique : le sang est redirigé vers le cœur et le cerveau. - Ces mécanismes préservent l’oxygène et induisent un profond état de calme.
Entre 3 et 4 minutes
À ce stade, les mécanismes de conservation de l’oxygène atteignent leur plein régime.
- Accumulation importante de CO₂. Seuls ceux qui ont développé une tolérance peuvent rester calmes.
- Premiers mouvements involontaires du diaphragme.
- L’activation parasympathique s’intensifie. Le rythme cardiaque diminue encore.
- Contraction de la rate : libération de globules rouges, ce qui augmente la capacité de transport d’oxygène.
- Ondes cérébrales :
- Diminution des ondes bêta (activité mentale) (Joshi & Telles, 2009).
- Augmentation des ondes alpha (Joshi & Telles, 2009).
- Augmentation de l’activité dans la bande thêta, associée à la méditation profonde et à l’intuition (Anusha et al., 2023), (Joshi & Telles, 2009).
- Cohérence interhémisphérique accrue, signe d’une meilleure coordination neuronale (Morelli et al., 2023).
- Les yogis expérimentés restent détachés, même face à l’inconfort.
Au-delà de 4 minutes
Passer le cap des 4 minutes n’est plus une simple prouesse : c’est une expérience d’introspection profonde, rare et exigeante, même chez les yogis avancés.
- Exige une profonde relaxation, une grande concentration et une bonne tolérance au CO₂.
- L’oxygène commence à approcher des niveaux critiques.
- Mouvements involontaires du diaphragme peuvent devenir incontrôlables.
- Si l’oxygène chute trop bas, la sécurité du corps s’active : perte de conscience (évanouissement).
- En cas d’évanouissement, le corps reprend automatiquement sa respiration.
- Pour les pratiquants très entraînés, un état de conscience altéré peut émerger.
- Silence mental, perte de la notion du temps, perceptions subtiles, sentiment d’unité.
- Une zone frontière où l’extrême physiologie rejoint l’expérience contemplative profonde.
Après la perte de conscience
Ceci est un point d’inquiétude qu’il faut adresser. Lors des noyades, des lésions cérébrales irréversibles apparaissent généralement après 4 à 6 minutes sans oxygène. Cela survient toutefois dans un contexte de lutte intense et paniquée, qui accélère l’épuisement des réserves en oxygène.
Chez un yogi ou un apnéiste entraîné qui perd connaissance dans un état de calme profond, la consommation d’oxygène est bien plus faible. Même en l’absence de renouvellement d’oxygène, il existe alors une marge de sécurité de plusieurs minutes avant que des dommages irréversibles ne se cristallisent.
Des études récentes ont montré que le corps humain est capable de maintenir l’oxygénation cérébrale même lors de longues apnées statiques, grâce à des ajustements cardiovasculaires remarquables, tels qu’une bradycardie prononcée, une vasoconstriction périphérique, et une redistribution du flux sanguin vers le cerveau (Bain et al., 2021). Ces mécanismes contribuent à une résilience accrue face au stress physiologique du manque d’air, confirmant les adaptations observées chez les pratiquants avancés.
Combien de temps les yogis retiennent-ils leur souffle ?
Chez les apnéistes, il arrive que certains perdent connaissance lors de compétitions — ce qui entraîne une disqualification immédiate. Mais dans le contexte du yoga, après avoir enseigné des milliers de séances de pranayama, je n’ai jamais vu quelqu’un s’évanouir en retenant son souffle, ni même entendu parler d’un tel cas. Aller jusqu’à la perte de conscience demande une volonté extrêmement forte et une motivation inhabituelle pour dépasser l’inconfort.
Dans les cours avancés que j’enseigne chez Yoga & Méditation Paris, mes élèves les plus expérimentés retiennent généralement leur souffle jusqu’à deux minutes. En retraite de yoga, il n’est pas rare que certains atteignent trois minutes. Au-delà, cela devient plus rare, mais reste tout à fait possible avec de la pratique régulière et une grande présence intérieure.
Chez les apnéistes, certains athlètes retiennent leur souffle plus de 10 minutes — le record mondial dépasse même 11 minutes. Mais cela se fait dans des conditions très spécifiques, dans un contexte compétitif et avec des années d’entraînement intensif.
Des études confirment que le corps humain est capable de maintenir l’oxygénation cérébrale même lors d’apnées statiques prolongées, grâce à des ajustements cardiovasculaires remarquables : bradycardie prononcée, vasoconstriction périphérique, et redistribution du flux sanguin vers le cerveau (Bain et al., 2021). Ces mécanismes contribuent à une résilience accrue face au stress physiologique du manque d’air, confirmant les adaptations observées chez les apnéistes comme chez les yogis.
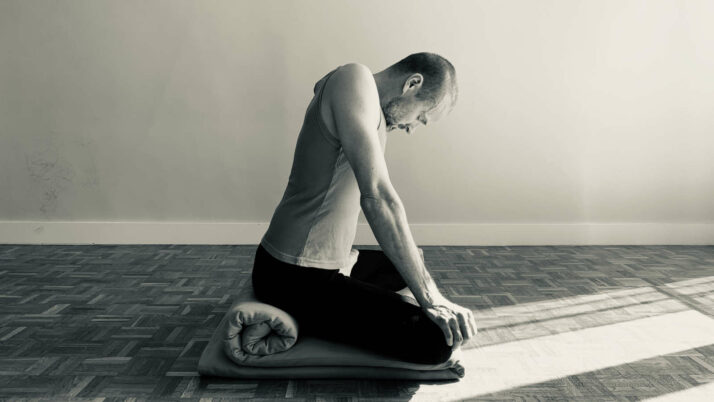
Que se passe-t-il lorsqu’on pratique régulièrement ?
Rétentions répétées dans une même séance
Lorsqu’on retient le souffle à plusieurs reprises au cours d’une même pratique, les réponses physiologiques s’enclenchent de plus en plus rapidement à chaque nouvelle rétention. Le corps semble se souvenir de ce qui vient. Cela accélère progressivement le déroulement des étapes décrites dans la chronologie ci-dessus. Tous les yogis qui travaillent en profondeur avec la respiration en font l’expérience : chaque rétention devient plus facile, plus profonde, et souvent plus transformatrice.
Chez Yoga & Méditation Paris, nous en sommes pleinement conscients. C’est pourquoi nous intégrons des rétentions à plusieurs moments de la séance : dès le début, dans certaines postures de yoga, et bien sûr lors des pratiques de pranayama elles-mêmes.
Les effets d’une pratique régulière : tolérance au CO₂, résilience et maîtrise intérieure
Avec la répétition au fil des semaines et des mois, les rétentions du souffle entraînent des adaptations profondes dans le corps et le système nerveux. La tolérance au dioxyde de carbone (CO₂) augmente : ce gaz, souvent perçu comme inconfortable au début, devient progressivement plus familier. Le seuil d’alerte respiratoire s’élève, permettant de rester calme plus longtemps face aux signaux internes de manque.
La bradycardie elle-même — ce ralentissement réflexe du rythme cardiaque — peut être entraînée : chez certains pratiquants avancés, la fréquence cardiaque peut diminuer de plus de 50 % (Panneton, 2013).
Ces adaptations ne sont pas uniquement physiologiques. Elles traduisent une modulation progressive du système nerveux autonome — notamment une augmentation du tonus parasympathique — accompagnée d’une meilleure régulation émotionnelle, d’une diminution du stress perçu et d’un sentiment d’ancrage intérieur renforcé (Joshi & Telles, 2009).
À plus long terme, certaines formes de pranayama pourraient contribuer à des changements durables dans le cerveau, en lien avec la plasticité neuronale. La répétition régulière de ces exercices favorise l’émergence de nouveaux schémas neuronaux, notamment dans les circuits liés à l’attention, à la régulation émotionnelle et à la conscience corporelle (Joshi & Telles, 2009).
Découvrez un yoga profond et puissant
Plongez dans un enseignement authentique le temps d’un stage de week-end à Paris.
La rétention du souffle : une méditation avec retour immédiat
Retenir le souffle n’est pas seulement un exercice physiologique. C’est aussi une forme de méditation active, avec un feedback immédiat et implacable : plus vous êtes présent et détendu, plus vous pouvez rester en apnée ; plus vous laissez le stress mental s’installer, plus vite vous craquez.
Cette pratique met en lumière le lien direct entre l’agitation intérieure et la physiologie : le souffle devient un miroir de l’état émotionnel. En apprenant à rester détendu dans l’inconfort, le pratiquant développe une résilience profonde et une capacité à garder son calme dans des situations exigeantes.
Avec le temps, cette forme d’exposition consciente au stress :
- Renforce le système parasympathique (repos et régénération),
- Améliore la régulation émotionnelle,
- Augmente la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) — un marqueur du tonus vagal et de la santé du système nerveux,
- Et entraîne une conscience corporelle accrue (interoception), similaire à celle développée dans les pratiques méditatives.
Les yogis expérimentés décrivent souvent les longues rétentions comme des portes vers un état de calme absolu, hors du temps, où les pensées s’estompent et où seule demeure la présence.
A retenir
- Ce n’est pas le manque d’oxygène mais l’augmentation du CO₂ qui déclenche l’envie de respirer – une nuance essentielle pour comprendre la rétention du souffle.
- Des mécanismes de survie puissants s’activent naturellement : ralentissement cardiaque, redirection du sang vers les organes vitaux, contraction de la rate… Le corps est remarquablement bien conçu pour faire face.
- Les effets physiologiques profonds apparaissent avec la durée, mais aussi avec la répétition : à chaque rétention, le corps réagit plus vite et plus profondément.
- La rétention consciente du souffle est un miroir de l’état intérieur : plus le mental est calme, plus le souffle peut être suspendu longtemps sans inconfort.
- À long terme, la pratique développe la tolérance au CO₂, la résilience émotionnelle, et la régulation du système nerveux, notamment à travers l’activation du système parasympathique.
- La rétention du souffle est aussi une forme de méditation : avec un retour immédiat, corporel et honnête — on ne peut pas tricher avec le souffle.
Sources
Anusha, N., Kalpana, R., & Vidya, A. (2023). A comparative EEG analysis of yoga breath-hold and non-yoga breath-hold. Unpublished manuscript. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/374266702
Morelli, M. S., Greco, A., Emdin, M., Scilingo, E. P., Valenza, G., Giannoni, A., & Vanello, N. (2020). Analysis of generic coupling between EEG activity and PETCO₂ in free breathing and breath-hold tasks using Maximal Information Coefficient (MIC). Scientific Reports, 10(1), 6974.
Panneton, W. M. (2013). The mammalian diving response: An enigmatic reflex to preserve life? Physiology, 28(5), 284–297.
Joshi, A., & Telles, S. (2009). A review on the neurophysiological correlates of pranayama. International Journal of Yoga, 2(3), 115–121.
Bain, A. R., Cocks, M., Subudhi, A. W., & Ainslie, P. N. (2021). Cardiorespiratory responses and brain oxygenation during five minutes of breath-hold (static apnea). Experimental Physiology, 106(11), 2321–2331.

Rencontrez votre auteur
Christian Möllenhoff
Professeur de yoga et formateur d’enseignants, Christian est reconnu pour sa pédagogie rigoureuse et inspirante. Il est le professeur principal de l’école Yoga & Méditation Paris, le créateur du site Forceful Tranquility, et l’auteur principal de ce blog.